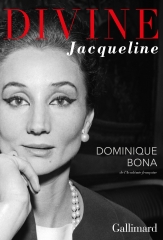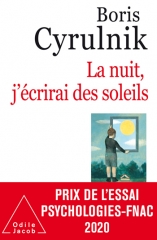Dans Divine Jacqueline, Dominique Bona ne parle ni d’une artiste ni d’un écrivain, mais d’une femme réputée pour son élégance exceptionnelle – « la dernière reine de Paris, la survivante d’un monde à jamais disparu » –, un modèle vivant qu’elle a pu interroger, qui lui a ouvert ses archives. Parmi les photos projetées sur la façade de l’Empire State Building le 19 avril 2017, à l’occasion des cent cinquante ans de Harper’s Bazaar, figurait une seule Française au « profil de pharaonne », celui de « la femme la plus stylée du monde » selon la presse américaine. En 2015, le Metropolitan Museum of Art lui a consacré une exposition prestigieuse : « Jacqueline de Ribes, the Art of Style ».

Jacqueline de Ribes photographiée par Richard Avedon, 1962 (détail)
Dominique Bona se souvient de leur premier entretien dans un hôtel parisien : « Très haute, très droite, elle s’arrête un instant dans l’encadrement de la porte ». Son allure impressionne, même à l’approche de ses quatre-vingt-dix ans. « Un nom d’ancienne France. Un titre de comtesse, après celui de vicomtesse qu’elle a porté jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans. Un rang social assuré. Une fortune, non moins exceptionnelle, héritée au berceau. Et le train de vie luxueux qui en découle. Enfin pour couronner le tout, la beauté, qui est un don des fées, une beauté enviable. »
Intriguée par l’histoire de cette « super-privilégiée », Bona l’académicienne s’intéresse à sa conception de l’élégance : pas qu’une affaire de vêtements, mais d’attitude, de recherche, de rigueur et de dignité – « une lutte permanente ». Jacqueline de Ribes porte de la Haute Couture, inspire les créateurs. Pour Yves Saint Laurent, elle était « Oriane », la duchesse de Guermantes. S’habiller est sa passion, elle aime concevoir des robes, des costumes ; elle a eu sa propre marque. « Elle est à sa façon une artiste, une artiste de soi. Car elle aime se créer. Sans cesse travailler son image. »
L’hôtel particulier des Ribes est au 50, rue de la Bienfaisance (Paris 8e). A l’occasion de son élection à l’Académie française, au printemps 2013, Bona y a été conviée à un « petit dîner » de vingt-quatre personnes en deux tables de douze. Elle y découvre un univers très proustien : argenterie, cristal, bougies, service en gants blancs.
« Née Bonnin de la Bonninière de Beaumont », un nom qui remonte aux Croisades, Jacqueline a pris son grand-père maternel pour modèle, Olivier de Rivaud, « un self-made-man », créateur de la banque Rivaud, passionné de courses. Elle ressemble à sa grand-mère Nicole de Rivaud, grande, élégante, qu’elle a beaucoup observée. « Je suis la fille de mes grands-parents. » Elle affirme que ses parents « n’aimaient pas les enfants, encore moins les leurs. »
La biographe s’intéresse aux ascendants, aux carrières, aux relations, aux modes de vie des uns et des autres. Jean de Beaumont aimait le sport, la chasse, les femmes. Paule de Beaumont avait toutes les qualités, mais pour sa fille, cette femme merveilleuse fut une mère sans amour, « distante et froide ». Jacqueline est née en juillet 1929, dix mois après leur mariage. En pension, elle n’a reçu aucune visite de sa mère, à qui ses propres parents avaient donné « une éducation parfaite mais pareillement distante. »
A dix-huit ans, elle rencontre Edouard de Ribes, vingt-quatre ans, aussitôt amoureux de la « belle gazelle ». Ils se marient en 1948 et habitent dans une aile de l’hôtel du comte et de la comtesse de Ribes, très conservateurs, qui imposent les rites et les horaires. Dominique Bona décrit le manque de lumière en journée dans cet hôtel « musée », qui se métamorphose la nuit pour les grands dîners en lieu féerique. Les enfants Ribes, à leur tour, verront peu leur mère.
Son fils se souvient des moments où celle-ci passait dans sa chambre se montrer à lui en robe du soir. A seize ans, Jacqueline avait rencontré Christian Dior et visité ses ateliers. Elle coud elle-même, retouche ses toilettes, elle sait construire une robe. Les fêtes, les bals costumés excitent sa fantaisie créative. Elle conserve tous ses costumes. Ses réceptions sont éblouissantes, elle soigne tous les détails.
Divine Jacqueline (le nom de la collection printemps-été 1999 de Jean-Paul Gaultier, en son honneur) : pour découvrir cette femme immortalisée par les meilleurs photographes, on suit Jacqueline de Ribes dans une succession de mondanités parisiennes et cosmopolites. Son goût du paraître, elle le met aussi au service des galas de charité et du mécénat, de productions théâtrales. Elle tient à ce que sa vie soit « un peu utile » et la mise en œuvre de ses projets, d’événements, l’exercice constant de sa créativité, lui ont permis de se libérer dans une certaine mesure de sa cage dorée.
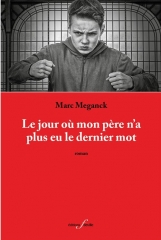 « Je ne lui connaissais pas cette patience. A dire vrai, je ne connais pas grand-chose de Kasper Braecke, si ce n’est sa passion pour les courses cyclistes et les documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, si ce n’est son racisme, son goût de l’Allemagne, et plus récemment celui des îles subarctiques et des voyages immobiles.
« Je ne lui connaissais pas cette patience. A dire vrai, je ne connais pas grand-chose de Kasper Braecke, si ce n’est sa passion pour les courses cyclistes et les documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, si ce n’est son racisme, son goût de l’Allemagne, et plus récemment celui des îles subarctiques et des voyages immobiles.